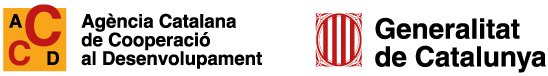Par Isabel Alvarez Vispo, présidente d’URGENCI..
Publié à l’origine, en anglais, sur le site web d’Urgenci..
Lorsque vous voyagez très loin, jusqu’au Sri Lanka par exemple, vous vous attendez à découvrir des paysages, des populations, des cultures, bref, une partie du monde très différente de votre quotidien. Et c’est effectivement ce que vous trouvez : des températures et un taux d’humidité que vous n’avez jamais connus, une culture et des sourires très différents des nôtres, ou encore un pays fortement militarisé qui nous montre un quotidien avec des codes et des scénarios très différents des nôtres. Cependant, il est surprenant (ou peut-être pas tant que ça) de constater que lorsque l’on observe des endroits tels que les zones rurales, l’oppression dont elles souffrent et même la manière dont elles y font face, les distances ne sont pas si grandes. Et c’est ce que nous avons constaté à Chandana Pokuna.
Chandana Pokuna est un village situé au nord du pays, près du lac Minneriya, avec un paysage caractérisé par des vergers et des rizières, où cohabitent éléphants, vaches et singes. Les habitants de ce village sont pour la plupart de petits agriculteurs qui ont de plus en plus de mal à survivre en raison des pressions du marché, du changement climatique et de la crise de la dette du pays, qui a conduit le gouvernement à mettre en œuvre des politiques d’austérité qui ont supprimé toute aide dont ils auraient pu bénéficier. Dans ce contexte, ils ont été ciblés par des entreprises qui viennent dans leur communauté leur proposer une solution miracle : le microcrédit.
Depuis des décennies, les microcrédits sont présentés comme un moyen pour les communautés les plus vulnérables d’accéder à des liquidités, en particulier pour les femmes, car nous savons que lorsque l’on parle de micro, cela nous vise toujours spécifiquement. La théorie consiste à accorder de petits prêts pour permettre l’investissement et le développement d’initiatives. Comme nous le savons, ces théories peuvent être bonnes jusqu’à ce que le marché et le capitalisme patriarcal (pardonnez la redondance) les prennent en main. En 2002, j’ai entendu une femme très expérimentée en Inde dénoncer le microcrédit comme un moyen d’extorquer les femmes des communautés les plus vulnérables de ce pays, et même la manière dont le microcrédit était utilisé comme un outil pour contrôler le corps des femmes, en exigeant qu’elles acceptent d’être stérilisées pour pouvoir en bénéficier. Il est important de savoir tout cela, car bon nombre de ces initiatives sont financées par des pays européens dans le cadre de leurs politiques de coopération internationale et sont présentées comme le moyen d’autonomiser les femmes dans leurs communautés.
Dans le cas du Sri Lanka, la formule consiste à faire venir des entreprises dans les communautés pour proposer des microcrédits. Pour ce faire, la première chose qu’elles font est de demander aux femmes leaders du village de former un petit groupe, qu’elles convainquent que leur offre est le meilleur moyen de résoudre leurs problèmes.
À partir de là, elles reçoivent pour instruction de faire passer le message : petits prêts, petits versements, tout est facile. Avec cette approche, des milliers et des milliers de femmes sont tombées dans le piège, car loin d’être la solution, le crédit devient un énorme fardeau, avec des taux d’intérêt très élevés, ce qui, dans ce cas, a conduit au suicide de plus de 200 femmes, selon les chiffres officiels, et à un grand nombre d’entre elles souffrant de graves problèmes de santé mentale. Lors de notre visite, on nous a dit qu’il n’existait pas de chiffres officiels sur le nombre de personnes vivant sous l’emprise du microcrédit, en raison de la honte que cela représente pour de nombreuses familles lorsqu’elles se rendent compte qu’elles sont piégées, mais qu’elles sont des milliers et des milliers.
C’est dans ce contexte qu’un groupe de femmes a décidé de s’organiser et de se rebeller contre cette extorsion. À Chandana Pokuna, les femmes ont commencé à se réunir et à chercher des moyens de subvenir à leurs besoins et de se libérer du fardeau que représente le fait d’être bénéficiaires de ces microcrédits. La première chose qu’elles ont décidé de faire est de lancer une grève collective des paiements, car elles estiment avoir été escroquées. Parallèlement, elles s’organisent et réfléchissent ensemble à des moyens non seulement de s’aider elles-mêmes, mais aussi d’empêcher d’autres personnes de se retrouver dans la même situation.
Sur cette base, elles ont décidé qu’elles avaient besoin de leur propre espace qui pourrait leur fournir des liquidités, et elles ont commencé à construire une petite communauté dans laquelle les membres doivent contribuer à hauteur de 100 roupies par mois et peuvent également contribuer avec une partie de leur récolte. Cette récolte est vendue collectivement, et les bénéfices sont distribués entre les agricultrices et le collectif afin de générer un fonds. Elles s’organisent également pour cuisiner leurs produits lors de différents événements et gagner ainsi un revenu supplémentaire, qui est à nouveau distribué entre celles qui contribuent en produits et en main-d’œuvre et le collectif lui-même. De cette manière, un espace communautaire autogéré est créé, dans lequel, petit à petit, elles construisent un lieu où elles se sentent libres. Il reste encore de nombreux problèmes à résoudre, mais c’est un espace où elles ont trouvé un soutien mutuel. (Comme le dit leur devise, lentement et modestement).

En outre, ils ont ajouté à leur objectif de se libérer de l’oppression monétaire celui d’améliorer leur santé et de prendre soin de la terre en éliminant les produits agrochimiques de leurs exploitations. L’utilisation de produits agrochimiques est un problème très important dans la région, au point qu’il n’y a plus d’eau potable en raison de la pollution qu’ils causent. Dans ce cas, le groupe a commencé à expérimenter dans ses exploitations le remplacement des intrants et l’intégration de techniques plus agroécologiques. Pour ce faire, elles organisent de petits champs d’essai dans leurs fermes où elles cultivent en utilisant différentes techniques et intrants (humus, diverses préparations, super-compost et aussi des produits chimiques). Chaque ferme enregistre à la fois les intrants utilisés et la récolte obtenue afin de vérifier les différences. En bref, cette communauté construit une transition agroécologique soutenue par la communauté, car ce collectif comprend non seulement des agriculteurs, mais aussi d’autres personnes qui ne cultivent pas la terre et apportent leur contribution pour la préserver.
Lorsque l’on entend cette histoire, en plus d’être ému par ces femmes, on se rend compte que, que nous soyons proches ou lointains, les réponses à ce capitalisme hétéropatriarcal qui nous étouffe tous (certains plus que d’autres) passent nécessairement par la construction d’espaces communautaires de soutien et d’autodéfense.
Car cette initiative n’est pas seulement un espace coopératif pour obtenir des financements, c’est un espace sûr, un espace qui prend soin, défend et soutient la vie face à un système pervers qui ne cherche qu’à augmenter ses profits au prix de la création de dépendances qui érodent la vie et la biodiversité. À des milliers de kilomètres de chez nous, nous avons compris que la réponse réside dans le fait d’avancer ensemble, en commençant petit et en allant lentement, afin de pouvoir, petit à petit, parcourir un long chemin.
©️ Photos par Nyeleni Global Forum.