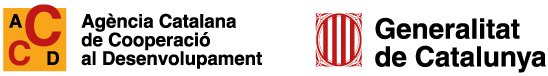Le 18 octobre 1995, le document Pour l’économie solidaire était publié dans le quotidien national français Le Monde.
En ce matin du 18 octobre, j’étais en France pour une mission de collaboration France-Québec dans le domaine de l’emploi. Avant d’embarquer dans le train (ou le métro), j’ai acheté l’édition du jour. J’ai eu une très agréable surprise en voyant ce texte.
Pour moi, c’était la première fois que je lisais un texte sur l’économie solidaire. En le lisant, j’ai compris que ça correspondait à ma vision, et à celle de biens d’autres acteurs que je connaissais, au Québec et en France. Je connaissais certains individus ou organisations signataires.
C’est fort probablement la première fois que l’économie solidaire en tant que concept était publié dans un grand quotidien national, que ce soit en France ou ailleurs.
Comme c’est un document très important qui marque les origines de l’économie solidaire, dont une partie du mouvement de l’Économie sociale et solidaire se réclame, il est pertinent de republier ce texte, avec une traduction en anglais et en espagnol.
Comme le copie dont je disposais provenait d’un microfilm (j’avais perdu la copie orignal), cette version est transcrite en format document pour traduire, en faire des extraits, etc.
Yvon Poirier
RIPESS
Original

Pour l’économie solidaire
Paru dans Le Monde, 18 octobre 1995
La référence à l’économie solidaire se répand dans les discours. Nous sommes concernés au premier chef par ce phénomène en tant que membres de réseaux, qui malgré leur hétérogénéité, nous paraissent s’inscrire dans cette perspective d’économie solidaire. Dans nos actions, nous nous confrontons concrètement aux problèmes qu’elles soulèvent et aux avancés qu’elle permet à travers la création et le fonctionnement de collectifs enfants-parents-professionnels pour l’accueil des jeunes enfants, de lieux d’expression et des activités artistiques, de restaurants multiculturels de quartier, de régies de quartier, et de multiples autres entreprises et services solidaires dans divers secteurs d’activité. Toutes les réalisations émanant de ces réseaux qui ont émergé dans les vingt dernières années représentent aujourd’hui des dizaines de milliers de salariés et de bénévoles. Las diffusion progressive de la notion d’économie solidaire nous réjouit parce qu’elle aide à faire connaître des milliers d’expériences dont l’action est peu médiatisée. Mais cet engouement se paie du prix de la confusion : il peut se révéler lourd de conséquences en entretenant le flou sur une approche qui, pour nous, se réfère à un choix de société.
L’économie solidaire est d’abord le refus de considérer que la seule solution consisterait à laisser d’épanouir une économie de marché libérée d’un maximum de contraintes, tout en élargissant, pour panser les plaies, le champ des actions sociales correctives.
En d’autres termes, l’économie solidaire ne serait habillée d’un vocable plus digne les mesures sieur traitement social du chômage qui ont été utilisés ces dernières années de manière massive (rappelons qu’il y a plus de 600000 contrats emplois-solidarité en 1994), ni des mesures visant à occuper les gens que l’on déclarerait inemployable dans une économie, dite normale. L’économie solidaire ne serait non plus se confondre avec d’autres formes d’économie dans un espèce de secteur fourre-tout qui légitimerait ‘il serait l’éclatement de la «condition salariale» : que ce soit avec d’économie caritative – qui présente le de substituer la sollicitude au droit – nous ramenant plus d’un siècle en arrière quand la philanthropie voulait soulager la misère en moralisant les pauvres, ou avec l’économie d’insertion quand celle-ci, uniquement conçue comme outil de transition et de sas de l’économie de marché, se constitue de fait en un secteur autonome; ou encore l’économie informelle qui ne permet guère que la survie des plus défavorisés sans leur permettre de reprendre pied dans la vie de la cité. En somme, l’économie solidaire ne saurait en aucun cas constituer une « économie balai » qui ramasserait les laissés-pour-compte de la compétitivité. Elle manifeste au contraire la volonté de réconcilier initiative et solidarité alors que ces deux valeurs ont été très souvent séparées: ç l’économie L’entreprise et au social le partage. L’objet de ce texte et donc de proposer une définition de l’économie solidaire susceptible de capitaliser ses acquis et de préciser ses enjeux. En effet, il nous semble que la réflexion sur les pratiques est le seul moyen d’aboutir à une conception pertinente économie solidaire, qui évite à celle-ci d’apparaître comme une expression gadgétisée, suscitant un engouement passager et vite remplacé par un autre mode tout aussi éphémère.
Des caractéristiques communes
Très diversifiés, portées par les acteurs d’origine socioprofessionnel différentes, les initiatives d’économie solidaire présentent toutefois de traits convergents :
Des personnes s’y associent librement pour mener en commun des actions qui contribuent à la création d’activités économiques et d’emplois tout en renforçant la cohésion sociale. La volonté d’entreprendre dont font preuve les promoteur qui s’y impliquent ne peut pas s’expliquer par l’attente de retour sur investissement mais est fondé sur la recherche de nouveaux rapports de solidarité qualité à travers les activités menées;
Les activités économiques créés ne peuvent aboutir dans le cadre du « tout libéralisme », ni dans celui d’une « économie administrée ». En fait, les réussites montrent qu’elles se pérennisent et se consolident dans de bonnes conditions lorsqu’elles reposent sur une combinaison équilibrée en différentes ressources (ressources marchandent obtenu par le produit des ventes, ressources non marchandes émanant de la redistribution, ressources monétaires issues de contribution volontaire), et lorsqu’elles arrivent à instaurer une complémentarité entre des entreprises professionnalisés et des formes d’engagement bénévole. De telles réalisations ont donc une portée qui dépasse la seule création d’emplois. Il s’agit d’une démarche de recomposition entre les sphères économiques, sociale et politique;
Au plan économique, elles suggèrent une approche « plurielle ». En favorisant l’hybridation des économies marchandes et non marchandes, monétaire et non monétaire, ces réalisations vont à l’encontre de la logique dominante unidimensionnelle qui aboutit au cloisonnement des différents registres de l’économie. Leur déontologie les engage à refuser le recours systématique à des statuts intermédiaires ou la banalisation des emplois domestiques, synonymes de « petit boulots ». Leur créativité les conduit à structurer les activités dans un cadre collectif organisé pour garantir la qualité des prestations et des emplois;
Au plan social, ces réalisations permettent la production de solidarité de proximité, volontaires, et choisies. Elles ont pour vertu d’activer des réseaux d’autant plus importants qu’ils s’insèrent dans un monde où se multiplie le phénomène d’isolement, d’anomie, de retrait ou de repli identitaire. En cela, elles échappent à un modèle communautaire sous tutelle de traditions et de coutumes et porteur de solidarité imposés. Au contraire, elles relèvent d’une solidarité engagée et choisie librement, ou les rapports personnels vont de pair avec l’égalité des participants dans l’action collective;
Au plan politique, elles concourent à rendent la démocratie plus vivante, en recherchant l’expression et la participation de chacun, quel que soit son statut (salarié, bénévole, usager, etc.), ce qui ne s’oppose pas à citoyenneté de délégation et de représentation, mais au contraire la renforce. La dimension politique de l’économie solidaire, trop souvent oublié, n’est pourtant pas la moins importante. Cette initiative constitue des « espaces publics » de proximité, c’est-à-dire des lieux permettant aux personnes de prendre la parole, de débattre, de décider, d’élaborer et de mettre en œuvre des projets économiques en réponse à des problèmes concrets qu’ils rencontrent. On peut à ce propos parler d’une contribution au lien civil à la sociabilité démocratique et la citoyenneté quotidienne.
Ainsi, au moment où la dynamique marchande ne suffit plus à fournir du travail pour tous, les initiatives de l’économie solidaire permettant de rendre la sphère économique plus accessible et de la « réencastrer » dans la vie sociale tout en évitant la solution d’un secteur « occupationnel » pour les chômeurs ou celle de la création d’emplois à tout prix dans un secteur dont le critère d’utilité sociale seraient définit centralement, avec le risque d’arbitraire que cela comporte. L’utilité sociale des activités ou des emplois ainsi créés est validé et légitimée par un réel débat local associant l’ensemble des acteurs. L’économie solidaire peut ainsi contribuer à constituer l’une des composantes de l’économie moderne. C’est une des voies possibles de la modernité, celle de la reconstruction d’espaces vécus et publics et solidarité autour du choix d’activité économique qui se fondent sur la pluralité des registres économiques.
LES CONDITIONS D’UN DÉVELOPPEMENT
Les appels à une reformulation des politiques d’emploi et de politique sociale se multiplient. Les politiques emblématiques des années 80, qu’elles concernent la ville ou insertion, sont de recherche d’un second souffle. Mais les blocages perdurent. D’une part, la question de l’emploi est toujours pensée de manière séparée, sans l’articuler avec la reconstruction du lien social et du lien politique. D’autre part, si un large consensus se fait sur la nécessité de renouveler la politique, les méthodes font défaut.
En fait, nous n’arrivons pas à sortir d’une situation bloquée : d’un côté, des programmes descendant à des publics cibles, qui s’appliquent de manière uniforme quels que soient les territoires concernés, de l’autre côté, des projets locaux d’activités, qui n’étant pas considéré que comme des tentatives singulières et non productives, ne pourraient à ce titre donner lieu à une véritable reconnaissance par les institutions. Ce clivage s’avère stérilisant : les grands programmes sont d’un coût élevé pour la finance puisque alors qu’elles induisent les effets bien connus d’aubaine et de substitution, les projets ancré dans la réalité ne trouve pas le soutien approprié parce que la volonté d’autonomie engendre la méfiance des financeurs et que leurs caractéristiques ne cadrent jamais dans les « cases administratives » délimités finies nationalement. Logique de programme et logique de projets s’opposent le plus souvent. Notre conviction est que, devant les problèmes que connait notre pays, il est temps de cesser ce se gâchis.
Si les réalisations de l’économie solidaire se sont imposées depuis deux trois décennies en dépit d’un contexte largement défavorable, c’est parce qu’elles sont porteuses de dynamique collective, de mode d’organisation inédits et de propositions novatrices. Il leur reste à se regrouper pour expliciter, mettre en synergie et amplifier leurs avancées respectives. Il apporte donc de trouver de nouveaux modes d’action collective qui ne procéderait pas de la seule action politique, mais d’un nouveau pacte social suscitant la coopération entre les pouvoirs publics et la société civile. Redéploiement de l’intervention de l’État social et affirmation de l’objet collectifs de projets vont de pair.
Dans cette perspective, il apparaît urgent à trouver les modalités d’une reconnaissance des initiatives et réseaux d’économie solidaire qui à la fois préserver leur autonomie -gage de leur productivité – et leur apporter un soutien à la mesure de leur contribution à la cohésion sociale et à la création d’emplois. Ce texte est la première expression collective issue de divers réseaux qui souhaitent se donner des moyens d’une parole publique respectueuses de leur identité.
C’est pourquoi nous appelons les acteurs qui se reconnaissent dans l’économie solidaire à se rencontrer, à se concerter pour mieux se connaître et pour élaborer, à partir des acquis des expériences et des obstacles rencontrés, des propositions pouvant être soumises aux autorités publiques.
Cet appel est signé par : Josette Combes, Solange Passaris (Accep); Collectif enfants-parents-professionnels (Acepp); Madeleine Hersent (ADEL); Activités pluriculturelles développées par des femmes; Agostino Burrini (ADSP); Relais local, région de Bourgogne; Jean Fregnac; Guy Michel; Yvon Trémel, premier vice-président du conseil général Côte d’Armor; ADSP; Réseau d’aide au développement au services de proximité; Annie Berger, Association régionale pour le développement de l’économie solidaire Basse-Normandie; France Joubert (CFDT), secrétaire général régional Poitou-Charentes; Charles Bouzols (Cnrlq), réseau des régies de quartier; Jacques Gautrat, conseil de le Flamboyance, plateau picard; Bernard Eme; Jean-Louis Laville (Crida), réseau d’aide au développement des collectivités, Christian Tyrgat (Giepp); réseau des entreprises solidaires de la région Nord, Bruno Collin (Opal); structures de pratique et de diffusion artistique; Jacques Archimbaud, réseau de l’économie alternative et solidaire; Françoise Giret, collectif enfants-parents Poitou-Charentes (Gicep).